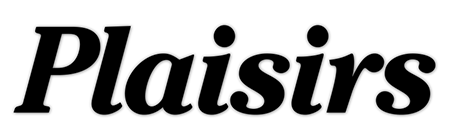HISTOIRE ET GASTRONOMIE: UN CROISSANT TRÈS FERTILE

L’histoire de l’alimentation a longtemps été boudée par les historiens universitaires, préoccupés d’histoire politique, diplomatique, militaire, et événementielle, qu’ils laissaient aux gastronomes.Ceux-ci se sontlongtempscantonnés au registre du pittoresque et de l’anecdotique, et aux légendes. Depuis que l’érudition historique est devenue, peu à peu, une composante du discours gastronomique, quelques mythes ont été contestés. Mais beaucoup d’autres demeurent.
Né en 342 avant notre ère, mort en 270, Épicure est un philosophe grec, fondateur, en 306, de l’une des plus importantes écoles philosophiques de l’Antiquité. Or, l’Épicurisme souffre encore aujourd’hui d’un malentendu. Il serait par excellence une philosophie du plaisir, un hédonisme, et l’épicurien un jouisseur, au mieux un bon vivant, au pire un débauché. Or, si Épicure fait bien l’éloge du plaisir, c’est dans le cadre d’un ascétisme raisonné. Il soutient que tout ce qui existe est composé d’atomes indivisibles qui se meuvent arbitrairement dans le vide, mais peuvent se combiner pour former la matière. L’âme, en particulier, comme le corps, ne serait, selon lui, qu’un agrégat d’atomes appelé à disparaître après la mort, et non une entité spirituelle. Sa vision de l’éthique réside dans la recherche d’un souverain bien – le plaisir – défini essentiellement comme une absence de douleur.
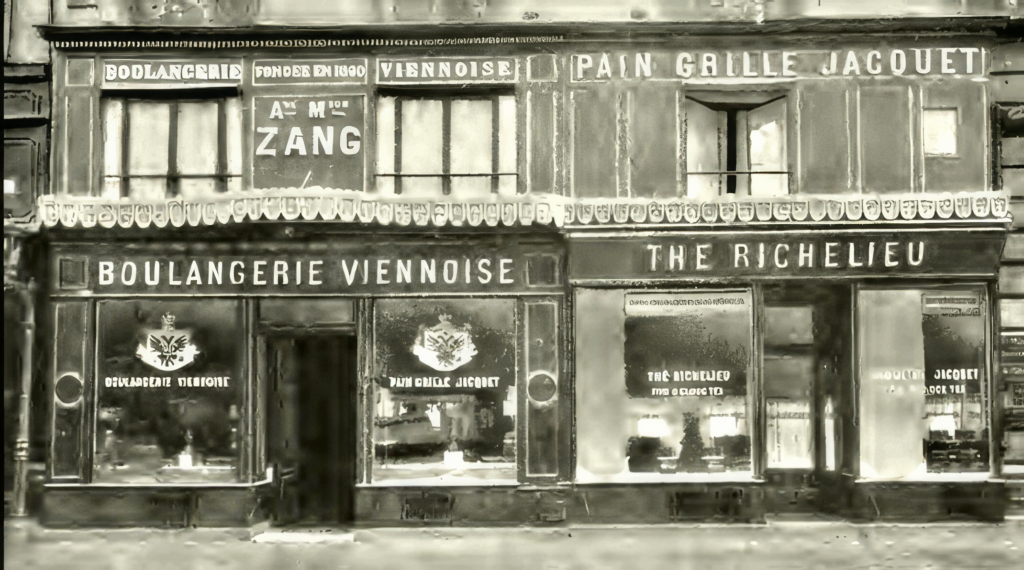
À 35 ans, il s’installe à Athènes, y achète un jardin, qui devient le centre des études épicuriennes. Jalousé, controversé par les platoniciens, il sera accusé des pires débauches dont il se défend vigoureusement. La vie qu’il mène dans son jardin, au milieu de ses disciples, est simple et frugale ; il est végétalien, ne mange ni œufs ni viande, à l’occasion du fromage. Selon l’un d’eux, « un verre de vin lui suffisait, et il buvait de préférence de l’eau. » Le Jardin d’Épicure est pourtant décrit comme un lieu de débauche, car les philosophes adorent les anathèmes. L’image d’Épicure est devenue celle d’un impie et d’un débauché, pire, d’un pourceau. Cette image sera amplifiée à Rome, lorsque le Christianisme, sous Constantin 1er, deviendra religion d’État de l’Empire. Ses écrits seront presque entièrement détruits sous le règne de Théodose 1er (379 – 395), car en récusant l’au-delà et l’immortalité de l’âme, en plaidant pour une morale sans dieu, un monde de valeurs sans transcendance, l’enseignement d’Épicure fut considéré comme matérialiste, imperméable aux dogmes de la nouvelle religion. Cet autodafé fut tel qu’il ne subsiste que quelques fragments de l’œuvre d’Épicure, rapportés par Lucrèce et par Diogène Laërce, biographe grec du IIIe siècle de notre ère : au total, seulement trois lettres et ses Maximes capitales. Les chrétiens ont atomisé son œuvre.