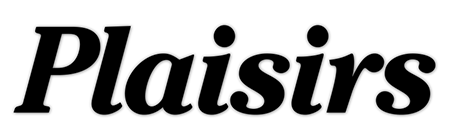Quand le bonheur est dans l’amertume

L’on réduit habituellement le goût aux quatre saveurs de base dont les combinaisons suffiraient à décrire notre univers sensible. Autant recomposer la palette chromatique du Tintoret avec les trois couleurs fondamentales! Aux siècles classiques, avec les raffinements de la table en Europe, inspirés de l’Italie, le goût s’était identifié au bon goût. Point n’était alors besoin d’une approche aussi simpliste que la distinction entre le sucré, le salé, l’amer et l’acide pour dire ce que l’on aimait ou que l’on n’aimait pas.
Il est vrai que les scolastiques s’étaient prononcés: «Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter.» Dès lors, sensibilité gustative et pratique culinaire entretiennent des rapports complexes. L’on dit le goût du sucre inné, mais comment expliquer que malgré une aversion naturelle, beaucoup sous nos latitudes–et parfois des populations entière–sont une préférence acquise pour l’amer et le piquant? Suze, Gentiane, Campari témoignent des penchants de toute une époque avant le déferlement des boissons sucrées. Les chocolats de crus n’hésitent plus de nos jours à afficher leur note amère. L’amande amère, bien sûr, mais aussi les olives taggiasche, la poutargue, la rhubarbe, les pissenlits et la scarole revendiquent leur appartenance à cette catégorie.
Sans oublier les herbes amères (maror) de la fête du Seder, qui évoquent les souffrances des Hébreux en Égypte. Les plus anciennes traditions culinaires de la Pâque juive sont liées aux récits bibliques du passage et du retour. C’est aussi le retour du printemps-ver sacrum chez les Anciens-marqué par la consommation de l’agneau, d’abord sacrifié au Temple par les Hébreux, puis partagé entre les fidèles de la Nouvelle Alliance. L’agneau pascal devient le symbole de la fête chrétienne. Le pain azyme, le gâteau pascal et les herbes amères que l’on trouve associées à ces repas, ont l’évidente signification de rappeler la rigueur de la condition humaine. Le légume de haut goût peut être une branche de céleri, le raifort ou le radis. Les constructeurs de pyramides, sur le plateau de Gizeh, le consommaient déjà, rose ou noir.
Tempérée par le soleil et le piment, la cuisine basque offre de nombreux exemples d’une cuisine où l’amertume est érigée en principe, sans nuire aux saveurs herbacées: saucisses sèches marinées dans l’huile avec des herbes, pimientos del piquillo, calamars à l’encre, axoa de veau au piment d’Espelette…
LE THÉ ET L’ORANGE DE SÉVILLE

De plus en plus nombreux aujourd’hui, sont ceux qui ont coutume de chasser les brumes matinales par un thé dont la fine amertume est à peine estompée par un nuage de lait façon Buckingham et une tartine de marmelade d’orange. D’orange amère de Séville, bien sûr, semblable à la bigarade, qui apparaît sur les marchés en hiver. L’amer serait-il une saveur de saison, comme la mortification des gibiers, la truffe ou le grain de genièvre?
«J’aime la discrète amertume des légumes, nous dit Guy Savoy, le haricot, le pois gourmand, le radis.» Il regrette, comme beaucoup, la disparition de l’endive amère, le chicon de nos amis wallons. Que sont devenus les silos des enfances paysannes, où l’on enfouissait sous le sable bientôt recouvert de la couche blanche de givre les racines raccourcies de la chicorée dont le forçage allait donner l’endive jaune pâle, d’octobre à la Chandeleur?