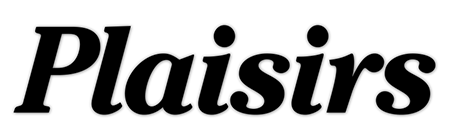GRAND ENTRETIEN AVEC BORIS WASTIAU, MANGER C’EST BIEN PLUS QUE ÇA

Jeune d’allure, une grande silhouette – 1 m 93 sous la toise – me rejoint autour d’une table du café de l’Alimentarium. Tout sourire et chaleureux à l’accueil, Boris Wastiau se montre concentré quand il répond aux questions, enthousiaste dans sa vision, mesuré dans ses propos. D’un côté, le manager, de l’autre l’anthropologue, l’historien. Un homme frotté adolescent déjà à d’autres cultures, et très tôt à la gestion d’un musée, en Belgique à 26 ans, puis à Genève, aujourd’hui à Vevey. L’entretien a duré près de deux heures. Extraits.
Boris Wastiau est né en Belgique, à Charleroi, en 1970. Sa mère enseigne la religion protestante. Son père est d’abord directeur de centres médico-sociaux s’occupant de jeunes en difficulté, avant de s’engager au service de programmes de développement en Afrique centrale, au Congo – le Zaïre à l’époque – au Burkina Faso, au Rwanda. Resté scolarisé en Belgique, le jeune Boris découvre l’Afrique pendant les vacances, à 15 ans, en même temps que le plaisir d’étudier sa culture au travers de la petite bibliothèque de brousse de son père. Il y avait là, notamment, un ouvrage d’un anthropologue français, Georges Balandier, Afrique ambiguë. « C’est ainsi qu’est né mon intérêt pour l’ethnologie, dont j’ai fait le sujet de mes études. »
Ce parcours va le conduire à l’Université libre de Bruxelles, puis aux universités de Coimbra, au Portugal, et d’East Anglia, en Grande-Bretagne, où il obtiendra son doctorat en 1997, avec une thèse sur les rituels de possession en Afrique centrale. Parallèlement, il a aussi beaucoup voyagé en Amérique latine. Mais dès 1996, il est engagé comme l’un des trois directeurs de collections du Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren, près de Louvain. Rebaptisée depuis AfricaMuseum, l’institution possède les plus incroyables collections africaines au monde.
En 2000, c’est là que Boris Wastiau organise une exposition qui va faire parler d’elle et de lui : ExitCongoMuseum, A Century of Art with/without Papers. 125 chefs-d’œuvre de l’art rituel congolais y sont présentés, accompagnés d’un appareil critique qui retrace leur origine et le mode de leur acquisition par les amateurs d’« art tribal ». En juin 2001, dans la revue Anthropology Today, Raymond Corbey la décrit comme un effort courageux, qui contribue à travers l’art à établir la « douloureuse cartographie d’un nouveau monde postcolonial ».
L’APPEL DE LA SUISSE
Le retentissement de l’exposition belge incite des étudiants de Jacques Hainard, alors directeur du Musée neuchâtelois d’ethnographie, à inviter Boris Bastiau à Neuchâtel. C’est le début d’un enchaînement de circonstances qui vont lui valoir, en 2007, d’être engagé comme conservateur des départements Afrique et Amérique du Musée d’ethnographie de Genève, le MEG. Jacques Hainard vient d’en prendre la direction pour les quelques années qui le séparent de la retraite. Et c’est Boris Wastiau qui lui succède en 2009.
Entré au Musée d’ethnographie de Genève en 2007, vous en devenez le directeur en 2009. Vous participez à la rénovation totale du musée qui s’installe dans un nouveau bâtiment contemporain en 2014. Le MEG obtient le Prix européen du musée en 2017. C’est un magnifique parcours. Pourquoi quitter Genève ?
B. W. Pendant ma formation, je n’avais jamais envisagé de travailler dans un musée. Je me voyais dans l’enseignement ou dans des programmes de développement. Et depuis, je n’ai jamais quitté les musées. Mais après onze ans en Belgique et douze au Musée d’ethnographie de Genève, j’avais envie de relever un nouveau défi. Le travail était fait, le MEG était lancé. En venant à l’Alimentarium, j’abordais un domaine différent, mais sans changer de métier ni d’intérêt. Je continue d’avoir une approche anthropologique, une approche universelle des humains, tous impliqués dans le système alimentaire.
Le communiqué de la Fondation Nestlé qui annonce la nomination, dès le 1er avril 2022, de Boris Wastiau à la tête du Musée de l’alimentation de Vevey ne dit pas autre chose. Pour expliquer le choix du nouveau directeur, il relève que « son approche internationale et son expertise anthropologique en font un atout majeur pour l’Alimentarium, dont la mission est de comprendre les enjeux de l’alimentation et sa relation avec la santé, les communautés et la planète. »
Qu’est-ce qui vous a séduit à l’idée de reprendre la direction de l’Alimentarium ?
B. W. L’Alimentarium est une institution qui doit beaucoup à son fondateur, Martin Schärer, un muséologue visionnaire qui a su en faire un projet thématique global. Ce n’est pas le musée d’une discipline, comme un musée des beaux-arts. Ce n’est pas un musée de niche, à l’image d’un musée de la Réforme. Ce n’est pas non plus le musée d’une collection, d’armes à feu ou d’objets de design par exemple. Dans le domaine de l’alimentation, on trouve aussi beaucoup de musées consacrés à un produit ou à une marque. L’Alimentarium est le seul projet qui englobe tous les aspects de l’alimentation et de la nutrition humaine dans le monde entier aussi bien qu’à travers les âges et toutes les disciplines qui peuvent s’y rapporter. Il s’agit d’une institution unique avec une vision anthropocène du monde dans lequel on vit. Et c’est dans ce domaine que mon expertise était attendue en même temps que de profiter de mon expérience acquise au MEG : au niveau international, mais aussi dans l’ouverture aux sociétés locales, aux réseaux sociaux et à la transition numérique d’un musée.
Vous êtes en fonction à l’Alimentarium depuis deux ans, quels objectifs vous êtes-vous fixés ?
B. W. Le premier objectif était de faire remonter le niveau de fréquentation. Jusqu’en 2016, l’Alimentarium enregistrait entre 60’000 et 75’000 entrées, ce qui est énorme pour un musée et une ville de cette taille. À partir de cette date, le recul, accéléré par la période Covid, a fait tomber la fréquentation jusqu’à 36’000 entrées. Nous accueillons aujourd’hui tout près de 50’000 visiteurs par an, sur la base d’un comptage beaucoup plus strict. Nous sommes donc sur la bonne voie grâce à l’engagement de toute l’équipe et du Conseil de Fondation. Pour y parvenir et aller plus loin, il a fallu mettre en place une nouvelle organisation, acquérir de nouvelles compétences et se projeter dans l’avenir. C’est ce que nous avons fait dès 2022 en présentant un programme stratégique Alimentarium 2025, date à laquelle l’établissement célébrera ses 40 ans.
Que faut-il attendre au-delà de ce premier succès ?
B. W. Ce programme anticipe la refonte progressive du musée dont les premiers effets seront visibles dès l’année prochaine. Nous avons sans attendre mis sur pied un programme d’activités qui n’existait pas, des ateliers culinaires, des événements, des conférences, des visites guidées. Il est décliné chaque semaine en fonction de nos différents publics et repose sur des partenariats dans le monde associatif, culturel, éducatif, économique. Signe de notre engagement sociétal, 24 partenaires participent aujourd’hui à notre programme.
L’adaptation des infrastructures pour augmenter nos capacités d’accueil et leur accessibilité, rendre possible une scénographie combinant expos permanente et temporaires, comme la création d’un auditorium, font partie de projets à plus long terme. De même que le repositionnement de notre identité verbale et visuelle en n’oubliant jamais, au final, la pertinence de notre présence au niveau local et international.
Quelles sont vos autres réalisations, les changements que vous avez apportés à l’Alimentarium ?
B. W. Sans pouvoir tout citer, je mentionnerai notre première exposition photos « Manger dehors » qui vous transporte d’un marché aux poissons en Corée du Sud à un repas de quartier au Mexique, en passant par une pause entre jeunes en Suède. Le repas en plein air, est-ce une mode de notre temps, ici une contrainte, là un plaisir convivial, une simple commodité ailleurs ? C’est à cela que répond l’expo. Elle est aménagée autour d’un petit forum en hémicycle qui nous permet d’organiser des rencontres, y compris en audiovisuel avec des conférenciers extérieurs.
Quels publics accueillez-vous et quels messages souhaitez-vous transmettre ?
B. W. Nos publics sont très variés. Il y a les autodidactes qui viennent ici par curiosité, pour apprendre. Il y a ceux qui cherchent à se distraire en participant à un événement, ou un moment de détente en famille ou entre amis. Ils vont par exemple participer à l’espace game. D’autres ont un lien personnel ou professionnel avec les métiers de bouche ou travaillent dans l’industrie agroalimentaire. Notre rôle est de répondre à ces différentes attentes en montrant, de manière plus ou moins ludique, que l’alimentation est un système complexe qu’il faut aborder et comprendre sur la base des faits plutôt que des idéologies.