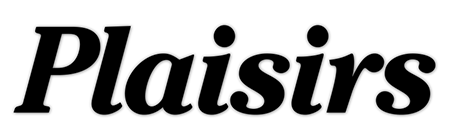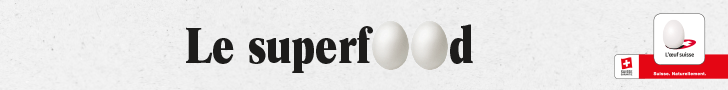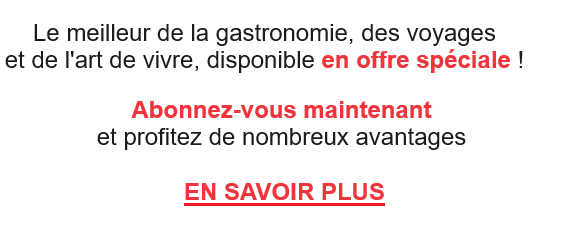LE PANAIS… IL EST PASSÉ PAR ICI, IL REPASSERA PAR LÀ…

Le panais est, à la Renaissance, une des principales ressources du temps de carême. Il figure alors comme garniture autour du poisson et même en tenait lieu, bien que, selon le médecin et botaniste Matthiole, ces « pastenailles frites (panais) incitent aux jeux de l’amour. » Le panais est alors le furet des repas du Haut Moyen-Age en Europe, avant de disparaître… et de réapparaître.
Le panais bénéficie d’un don de bilocation tel Saint Joseph de Cupertino, chaque fois sous un nom différent : panais, chervis, pastenaille, pastinacier. Après une longue éclipse, il réapparait dans la seconde moitié du XXe siècle et prend part désormais au renouveau des légumes oubliés. Le panais était connu en Suisse où l’on a retrouvé sa trace dans des sites néolithiques sur les bords du Lac de Constance. Mais, comme un peu partout, il a laissé les carottes le supplanter peu à peu, en particulier son sosie, la carotte blanche de Küttingen, ancienne variété suisse à croissance rapide. Et pourtant, les panais présentent, comparés aux carottes, une teneur en fibres, potassium et vitamine C quatre fois plus élevée et cuisent deux fois plus rapidement. La racine du panais accumule de l’amidon qui évolue pour partie en sucre sous l’action du froid, car c’est un légume d’hiver, dont le goût est renforcé après un gel. Au XVIIIe siècle, un marchand de graines potagères vantait la sélection d’un panais sucré de Hollande sous le nom de « panais royal.» En Thuringe, on produisait même un sirop à partir des racines de panais.
Panais et carottes appartiennent à la même famille botanique des Apiacées (appelées autrefois Ombellifères) où voisinent légumes, plantes aromatiques et épices : céleri, fenouil, anis vert, cerfeuil, persil, cumin, coriandre, et aussi la grande cigüe qui fut fatale à Socrate ! On ne peut guère parler de famille botanique, car les naturalistes du Moyen Âge, jusqu’à la Renaissance, considéraient d’abord ces plantes comme des « légumes racines » : peau coriace et texture fibreuse, odeur typée, forme grêle et allongée. Il fallut attendre Linné, le naturaliste suédois, pour mettre un peu d’ordre dans leur classification. Mis au second plan par la carotte, le panais eut aussi à subir la concurrence des pommes de terre découvertes au Pérou vers 1530 sur les plateaux andins par les Conquistadors. Bientôt, le panais fut remplacé par la patate, plus facile à cultiver et surtout plus productive. En 1856, Vilmorin distingue encore deux types principaux, l’un, long et ridé sans doute le plus ancien, l’autre court et rond. Ils sont cultivés et très appréciés en Angleterre et en Europe du Nord. Toutefois en 1938, les panais disparaissent des statistiques agricoles de la Confédération.

REGAIN D’INTÉRÊT POUR LE PANAIS
Ces dernières années, la Suisse a marqué un regain d’intérêt pour les légumes oubliés, non pour satisfaire aux caprices de la mode, mais grâce à l’action convergente des associations de consommateurs et d’organismes tels ProSpeciaRara, fondation crée en 1982, et Coop qui ont remis au goût du jour des variétés anciennes de fruits et de légumes, sous leur propre label. La Fédération Romande des Consommateurs (F.R.C.) souligne : « l’intérêt à cultiver et à consommer des produits adaptés à notre terroir, à notre climat. C’est aussi favoriser la biodiversité et défendre la liberté de choix du consommateur.» L’écueil toutefois est d’encourager la nostalgie au détriment de la curiosité, quitte à payer les produits un peu plus chers. Mais attention, l’agriculture industrielle, flairant la bonne affaire, produit aussi des légumes qui semblent anciens et rustiques, mais n’ont pas leurs qualités organoleptiques, et ont même quelque chance d’avoir été confrontés aux pesticides.
Vous souhaitez lire l’intégralité de cet article ?
Abonnez-vous pour accéder aux contenus complets en recevant chaque 2 mois la nouvelle édition du magazine chez vous !