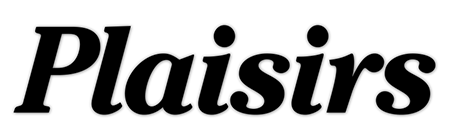Raisin de table: entre terroirs, traditions et modernité

«Merci, je n’ai pas coutume de prendre mon vin en pilules» répondit avec humour Brillat-Savarin à un quidam qui lui présentait une grappe de raisin. Propos singulier, car, dès cette époque, le raisin n’est pas seulement la matière première du vin. En Europe, il se déguste aussi à la grappe, sur les marchés, à la fin des repas ou lors des fêtes de fin d’année. Derrière ce fruit à la fois familier et raffiné, se cache un univers de savoir-faire agricoles, de traditions locales et de circuits commerciaux qui façonnent encore aujourd’hui notre rapport au goût. En 2023, 72,5 millions de tonnes de raisin ont été récoltées dans le monde, dont 71% pour la vinification, 27% pour le raisin de table, 2% pour d’autres usages, les raisins secs notamment.
Un constat préalable s’impose: tous les raisins de table et de cuve européens sont issus de Vitis vinifera, dont la Lambrusque (sylvestris) est la forme sauvage ancestrale appartenant à la même espèce botanique. C’est la forme spontanée de la vigne, dioïque (pieds mâles et pieds femelles séparés), poussant dans les forêts, haies et bords de rivières. Ses baies sont petites, acides, souvent noires ou bleu sombre, et inadaptées à la culture fruitière ou vinicole. Mais elle a donné naissance à la vigne cultivée par sélection et domestication il y a environ 8000 ans, dans le Caucase et le Proche-Orient. Elle a encore aujourd’hui une descendance indirecte: sa génétique se retrouve dans le patrimoine des cépages actuels, notamment par hybridations anciennes.
VARIÉTÉ OU CÉPAGE
La différenciation entre raisins de table et de cuve n’est donc pas une différence d’espèce, mais une sélection humaine au sein de la même espèce. Il faut alors s’entendre sur une nuance du vocabulaire appliquée au raisin: variété ou cépage? Dans le langage courant comme dans la littérature horticole, on parle de variétés pour désigner les différents types de raisin destinés à être consommés frais, par exemple: Italia, Sultanine, Muscat d’Alexandrie, Crimson Seedless. Cette terminologie renvoie au monde du fruitier, au même titre qu’on parle de variétés de pommes ou de poires. La logique est essentiellement commerciale: couleur, taille du grain, présence ou absence de pépins, croquant, aptitude à la conservation et au transport.
En revanche, la viticulture ou l’oenologie, ne reconnaît que les cépages pour désigner les baies destinées à la vinification, par exemple: pinot noir, cabernet sauvignon, syrah, chasselas (rares sont les raisins qui peuvent être à la fois cépage et variété de table). La notion de cépage en effet est liée à la typicité du vin qu’il produit: arômes, structure, degré alcoolique, adaptation au terroir. Le mot «cépage» (issu de cép, souche en vieux français) renvoie donc directement au vocabulaire de la vigne et du vin.
Certaines variétés peuvent être utilisées à la fois comme raisins de table et comme raisins de cuve (vinification): c’est le cas du chasselas en Suisse et en France, du Muscat d’Alexandrie ou du grenache dans certaines régions. Mais globalement, la sélection est différente. Retenons deux principes directeurs: les Variétés de table présentent de gros grains, peau fine, chair croquante, aspect visuel séduisant. Tandis que les Cépages de cuve se caractérisent par de petits grains, une peau épaisse (source de tanins et anthocyanes), une plus forte richesse en sucre, moins de recherche esthétique.


UNE ALLÉGEANCE CLIMATIQUE
Les grandes zones de production de raisin de table en Europe se concentrent dans les régions méridionales, là où le climat méditerranéen assure soleil et douceur. L’Italie est le premier producteur européen, avec les Pouilles et la Sicile comme épicentres. Le raisin y est cultivé aussi bien pour la consommation intérieure que pour l’exportation. L’Espagne est un autre géant du raisin de table, notamment autour de Murcie et d’Alicante. C’est là que naît la tradition des «douze grains de raisin», avalés à minuit le 31 décembre pour conjurer la malchance. La Grèce reste réputée pour ses raisins blancs croquants et ses variétés destinées au séchage (sultanine, corinthe). La Suisse récolte des raisins destinés en quasi totalité à la vinification. La consommation intérieure de raisins de table de la Confédération, estimée à environ 40 000 tonnes par an…